Les deux premières parties du dernier ouvrage de Thomas Piketty, Capital et idéologie (Le Seuil, 2019) consacrent de longs développements aux sociétés précapitalistes. Il considère que ces dernières se partagent entre des sociétés esclavagistes et des « sociétés ternaires » ou « sociétés trifonctionnelles » (page 248), un concept pour le moins discutable comme nous allons le voir. [Cet article fait suite à une première contribution intitulée «Capital et idéologie»: un titre en trompe-l’œil]
Sociétés ternaires ou sociétés à idéologie ternaire ?
Une société ternaire (ou société trifonctionnelle) est, selon Thomas Piketty, une société dont l’ensemble des membres se subdivise en trois groupements : le clergé, la noblesse et le tiers état, caractérisés chacun par l’exercice d’une fonction sociale déterminée.
« Le clergé est la classe religieuse et intellectuelle : elle est chargée de la direction spirituelle de la communauté, de ses valeurs et de son éducation ; elle donne du sens à son histoire et son devenir et lui fournit pour cela les normes et repères intellectuels et moraux nécessaires. La noblesse est la classe guerrière et militaire : elle manie les armes et apporte la sécurité, la protection et la stabilité à l’ensemble de la société ; elle permet ainsi d’éviter que la communauté ne sombre dans le chaos permanent et le brigandage généralisé. Le tiers état est la classe laborieuse et roturière : elle regroupe le reste de la société, à commencer par les paysans, artisans et commerçants ; par son travail, elle permet à l’ensemble de la communauté de se nourrir, de se vêtir et de se reproduire. » (page 72).
Thomas Piketty emprunte ce schéma à Georges Dumézil (1898-1986). Mais, alors que ce dernier limitait ce schéma trifonctionnel aux seules sociétés dites indo-européennes, en en faisant la caractéristique propre, Thomas Piketty l’étend à un très grand nombre des sociétés précapitalistes, largement dispersées dans l’espace et le temps.
« On retrouve ce type général d’organisation sociale non seulement dans toute l’Europe chrétienne jusqu’à la Révolution française, mais aussi dans de nombreuses sociétés extraeuropéennes et dans la plupart des religions, en particulier dans le cadre de l’hindouisme et de l’islam chiite et sunnite, suivant des modalités différentes (…) Le schéma ternaire se retrouve dans la quasi-totalité des sociétés anciennes et dans toutes les parties du monde jusqu’en Extrême-Orient, en Chine et au Japon, avec quelquefois des variantes substantielles qu’il convient d’étudier, car elles sont au fond plus intéressantes que les similitudes superficielles. » (pages 72-73).
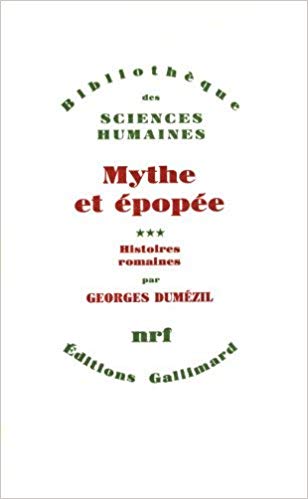 Pareille extension est parfaitement abusive et Thomas Piketty y procède d’ailleurs sans autre forme de démonstration ou justification, et pour cause. En réservant pour l’instant le cas de l’aire indo-européenne, quoi que dise Thomas Piketty, on ne trouve nulle trace de ce schéma trifonctionnel dans les empires arabes classiques (omeyyade, abbasside, fatimide, etc.), pas davantage dans les autres empires musulmans (mamelouk, mongol, timourides, ottoman, safavide, moghol), pas plus d’ailleurs que dans la Chine impériale (des Han aux Qing) ou au Japon (y compris durant sa période féodale accomplie sous le shogunat Tokugawa) [1]. Et, de toutes les grandes religions, l’hindouisme est le seul à avoir développé ce schéma, qu’on ne retrouve ni dans le bouddhisme, ni dans le judaïsme, ni dans l’islam. Quant au christianisme, il ne s’est laissé aller à développer pareil schéma que dans le cadre du catholicisme médiéval ; ce qui suffit à démontrer que ce schéma n’est pas consubstantiel à cette religion.
Pareille extension est parfaitement abusive et Thomas Piketty y procède d’ailleurs sans autre forme de démonstration ou justification, et pour cause. En réservant pour l’instant le cas de l’aire indo-européenne, quoi que dise Thomas Piketty, on ne trouve nulle trace de ce schéma trifonctionnel dans les empires arabes classiques (omeyyade, abbasside, fatimide, etc.), pas davantage dans les autres empires musulmans (mamelouk, mongol, timourides, ottoman, safavide, moghol), pas plus d’ailleurs que dans la Chine impériale (des Han aux Qing) ou au Japon (y compris durant sa période féodale accomplie sous le shogunat Tokugawa) [1]. Et, de toutes les grandes religions, l’hindouisme est le seul à avoir développé ce schéma, qu’on ne retrouve ni dans le bouddhisme, ni dans le judaïsme, ni dans l’islam. Quant au christianisme, il ne s’est laissé aller à développer pareil schéma que dans le cadre du catholicisme médiéval ; ce qui suffit à démontrer que ce schéma n’est pas consubstantiel à cette religion.
Mais que Thomas Piketty se laisse ainsi aller à mettre sur le même plan sociétés et religions (le schéma ternaire se rencontre « dans de très nombreuses sociétés extraeuropéennes et dans la plupart des religions ») doit nous mettre la puce à l’oreille et nous aiguille en fait vers une critique bien plus radicale encore de l’usage qu’il fait de ce schéma ternaire. En fait, dans tous les cas où il peut effectivement s’observer, ce dernier se rapporte moins à la structure même des sociétés concernées (à ses rapports sociaux fondamentaux : rapports de production, rapports de reproduction, etc.) qu’à leur voile et ciment idéologiques, autrement dit à la manière dont les groupements qui y sont dominants se représentent eux-mêmes et se représentent l’organisation sociale pour y justifier leur situation [2]. En un mot, il n’y a pas de sociétés ternaires, il y a tout au plus des sociétés à idéologie ternaire.
Mais c’est le moment de se souvenir que, comme j’ai eu l’occasion de le rappeler dans mon précédent article consacré à l’ouvrage de Thomas Piketty [3], une idéologie n’est pas seulement un discours mais, plus largement, un système culturel (au sens anthropologique du terme) qui façonne par conséquent, au-delà des opinions et des mentalités, les mœurs individuelles et collectives, par conséquent les habitus, les attitudes, les comportements, les relations interindividuelles, les apparences que l’on se donne à soi et aux autres, les institutions chargées de réguler et codifier ces relations, comportements et attitudes, etc. Autrement dit, une idéologie façonne toujours la réalité sociale dans une certaine mesure, en la coulant dans des apparences et apparats symboliques et imaginaires qui ont surtout pour fonction de masquer ou de légitimer des aspects bien plus importants mais moins honorables de cette même réalité – sans quoi elle ne serait pas idéologie. Dès lors, s’en remettre à l’idéologie dominante d’une société (qui est toujours celle du ou des groupements qui y sont dominants) pour comprendre cette société, c’est à coup sûr passer à côté de ses rapports sociaux essentiels.
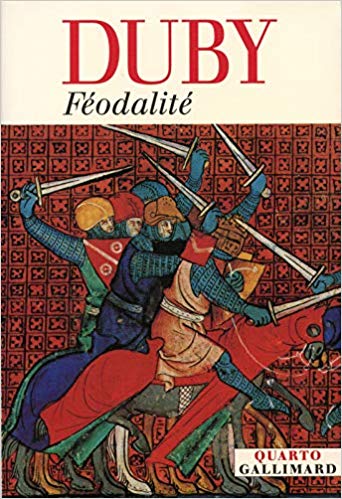 Montrons-le brièvement sur l’exemple de la société féodale européenne, qui est celle des sociétés à idéologie ternaire qui nous est sinon la plus familière, du moins la moins étrangère, celle aussi à laquelle Thomas Piketty accorde le plus de place dans ses propres analyses des sociétés précapitalistes. Son idéologie ternaire, son « imaginaire » comme le dit Georges Duby, nous la représente sous la forme d’une harmonie fonctionnelle entre oratores (ceux qui prient pour le salut de tous), bellatores (ceux qui combattent pour défendre la sécurité de tous) et laboratores (ceux qui travaillent pour tous – et surtout pour d’autres qu’eux-mêmes…). Harmonie que ne cesse de célébrer Thomas Piketty lui-même en se félicitant « des coopérations rendues possibles par des alliances nouvelles entre les différentes classes de la société ternaire » (page 93).
Montrons-le brièvement sur l’exemple de la société féodale européenne, qui est celle des sociétés à idéologie ternaire qui nous est sinon la plus familière, du moins la moins étrangère, celle aussi à laquelle Thomas Piketty accorde le plus de place dans ses propres analyses des sociétés précapitalistes. Son idéologie ternaire, son « imaginaire » comme le dit Georges Duby, nous la représente sous la forme d’une harmonie fonctionnelle entre oratores (ceux qui prient pour le salut de tous), bellatores (ceux qui combattent pour défendre la sécurité de tous) et laboratores (ceux qui travaillent pour tous – et surtout pour d’autres qu’eux-mêmes…). Harmonie que ne cesse de célébrer Thomas Piketty lui-même en se félicitant « des coopérations rendues possibles par des alliances nouvelles entre les différentes classes de la société ternaire » (page 93).
Mais cet imaginaire, qui nourrit l’apparat social des privilèges dont sont parés les deux premiers ordres (par exemple les vêtements et cérémonies dans lesquels ils se donnent à s’admirer, les préséances curiales, le système des patronymes nobiliaires, etc.), nous masque les rapports sociaux de production qui les lient. Où est-il question dans ce schéma trifonctionnel, par exemple, de la propriété du sol, principal moyen de production dans ces sociétés essentiellement agraires, que les deux ordres privilégiés accaparent largement et qui constitue la base économique de leur puissance sociale et de leur pouvoir politique [4] ? Où y est-il question par conséquent de l’exploitation du travail des paysans (et artisans ruraux), sous forme de l’extorsion de redevances en nature ou en espèces (chevage, formariage, cens, dîmes, amendes pénales, mainmorte) et de l’exécution de corvées, sur lesquelles se fonde réellement leur richesse ? Et, au sein même du tiers état, que nous est-il dit dans ce schéma de la différence essentielle entre la situation des paysans et artisans asservis (réduits au statut de serfs, dans leur immense majorité) à la campagne et celle des artisans et des commerçants qui, logés à la ville, vont pouvoir (non sans luttes quelquefois sanglantes) se placer hors d’atteinte ou s’émanciper de la tutelle seigneuriale de la noblesse et du clergé, acquérir le statut de « bourgeois » libres et transformer la ville (et plus encore les ligues urbaines) en base et cadre de leur montée en puissance marchande [5] ? Rien de tout cela n’affleure même seulement dans le « récit » ternaire auquel s’abandonne si volontiers Thomas Piketty. Définir et expliquer le féodalisme par son idéologie ternaire, c’est comme vouloir définir et expliquer le capitalisme par son idéologie individualiste, démocratique et méritocratique – ce que Piketty fait d’ailleurs en bonne partie, ainsi que nous le verrons encore.
En définitive, Thomas Piketty confond la société (les structures sociales) avec ce qu’en dit son idéologie justificatrice ; pire, il réduit la première à la seconde, en versant ainsi dans une conception idéaliste (au sens philosophique) de l’histoire. Ce qui se manifeste encore, par exemple, dans sa tentative d’expliquer la genèse et la persistance des soi-disant « sociétés ternaires » par des motifs psychologiques : par les besoins de sens et de sécurité que satisferait l’institution de deux ordres privilégiés censés les satisfaire, respectivement le clergé et la noblesse.
« Le besoin de sécurité et celui de sens ont toujours été deux besoins essentiels (…) Dès lors que des groupes religieux et militaires sont en mesure d’apporter des réponses crédibles à ces besoins de sens et de stabilité, dans le cadre d’institutions et d’idéologies adaptées aux territoires et aux époques en question (…), il n’est guère étonnant que l’ordre trifonctionnel puisse apparaître comme légitime aux yeux des populations concernées. » (page 81).
Encore faudrait-il expliquer pourquoi ces besoins, réputés essentiels donc universels, ont trouvé à se satisfaire sous cette forme dans les « sociétés ternaires » et, manifestement, sous d’autres formes en d’autres temps et d’autres lieux, sous d’autres circonstances sociales.
Sur le féodalisme
Sur de pareilles bases, il n’est pas trop étonnant que Thomas Piketty ne saisisse pas certains aspects pourtant essentiels des structures sociales et des transformations historiques des sociétés précapitalistes. A commencer par les sociétés féodales européennes.
Les quelques pages qu’il y consacre appréhendent mal leurs deux institutions clés que sont la seigneurie (laïque ou cléricale) et la hiérarchie féodale qui donnent forme à leurs rapports de production et de propriété [vi]. La seigneurie personnelle est celle qui asservit des paysans ou artisans d’un territoire déterminé à la personne même du seigneur : elle en fait ses serfs, en les rendant redevables de différentes prestations à son égard (chevage, formariage, mainmorte). La seigneurie foncière fait du seigneur le possesseur sinon le propriétaire éminent d’une terre, partagée entre sa réserve, qu’il fait exploiter par ses serfs sous forme de la corvée, et une mouvance divisée en tenures paysannes sur lesquelles les serfs sont censés produire de quoi s’entretenir eux-mêmes, tout en lui versant quelques redevances. Enfin la seigneurie banale procède de la décomposition du pouvoir politique dans le cours du Haut Moyen Âge (entre le VIe et le Xe siècle), en confiant à son dépositaire le droit d’exercer des prérogatives d’ordre public que sont tenus de respecter tous les hommes de son ressort, libres ou asservis : rendre la justice (ce qui lui permet de percevoir des amendes pénales ou des droits sur les mutations foncières appelés lods), prélever des taxes (la taille seigneuriale), imposer des monopoles d’équipements collectifs (moulins, fours, pressoirs, ponts, etc.) dont l’usage est payant, éventuellement même battre monnaie (et prélever au passage le seigneuriage), etc. Ajoutons que ces différentes seigneuries ne se concentrent pas nécessairement entre de mêmes mains : si les deux premières sont ordinairement réunies (bien que ce ne soit pas toujours le cas), la troisième ne leur est pas nécessairement conjointe ; ce qui explique la fréquence et la récurrence des sources de conflits entre les différents seigneurs, dont peuvent profiter leurs sujets.
Le pouvoir de chacun d’eux n’est de surcroît pas absolu : il est pris lui-même dans une hiérarchie féodale, suite plus ou moins longue de dépendances personnelles liant vassaux et suzerains. Sa terre n’est la plupart du temps qu’un fief, qu’il a obtenu de la part d’un seigneur plus puissant dont il est le vassal ; entré à son service, il s’est fait son homme (c’est là le sens propre de l’hommage) et il lui doit, à ce titre, outre une fidélité irréprochable, différents services : l’aider financièrement ou militairement quand son suzerain le lui demande, participer à ses conseils et plaids, etc. Son suzerain, inversement, lui doit également secours et assistance. Mais ce suzerain peut être lui-même le vassal d’un seigneur plus puissant encore, et ainsi de suite, l’ensemble s’ordonnant depuis l’empereur, le roi ou le prince jusqu’aux plus modestes de leurs barons et chevaliers en passant par les ducs, marquis (ou margraves), comtes et vicomtes.
C’est la combinaison de ces deux institutions qui explique cette double singularité du féodalisme à ses origines que sont la décomposition du pouvoir politique et celle de la propriété foncière. Or, si Thomas Piketty saisit bien la première sans pour autant l’expliquer, il ne mentionne la seconde qu’en passant et en des termes des plus vagues [7]. A ses origines, le féodalisme procède en effet d’un véritable émiettement du pouvoir politique, consécutif à l’incapacité de reproduire les structures impériales héritées de l’Empire romain (au terme de l’échec de son ultime tentative de reconstitution par les Carolingiens) et à la montée des périls dans les campagnes (sous le coup de luttes entre seigneurs, des invasions normandes, sarrasines et magyares), conduisant à disséminer ce pouvoir dans la hiérarchie féodale.
Mais le féodalisme ne se caractérise pas moins par la décomposition de la propriété foncière, qui est d’égale importance pour comprendre ce qu’il en est du féodalisme et de sa dynamique. Dans les rapports féodaux de production, il n’y a pas place pour la propriété foncière privée dite quiritaine par le droit romain, celle qui concentre entre de mêmes mains l’usus (la possession effective de la terre, le droit d’en user en la mettant en valeur), le fructus (la jouissance des fruits de cette terre et de ce travail) et l’abusus (la propriété éminente qui autorise son détenteur à transmettre ou aliéner le bien-fonds) [8]. Tout seigneur n’est lui-même que le simple possesseur usufruitier de son fief, dont l’abusus reste entre les mains de son suzerain, possession usufruitière au départ simplement temporaire ou au mieux viagère, que le vassal va évidemment chercher à rendre héréditaire en faisant entrer son propre aîné dans la suite de son suzerain ; mais, même dans le cas d’une possession héréditaire, son suzerain a le droit de lui retirer son fief en cas de manquement grave à ses devoirs (désobéissance, rébellion, traîtrise, etc.), de même qu’il a le droit de récupérer le fief en cas d’absence d’héritier direct (c’est ce qu’on nomme le retrait féodal). De même, le paysan asservi dispose bien de l’usus de sa parcelle (on dit qu’il en est le tenancier, le possesseur effectif) et il ne peut pas en principe en être privé tant qu’il remplit ses obligations envers son seigneur, mais c’est ce dernier seul qui dispose de l’abusus, tandis que les deux se partagent le fructus ; de même que seigneurs et communautés paysannes se disputent l’usus, le fructus et même l’abusus des terres communales. A ce régime complexe de la propriété foncière, juxtaposant et superposant des droits différents et concurrents, nécessairement source permanente de conflit, il est à peine fait allusion dans l’exposé de Thomas Piketty. On mesure sur cet exemple ce qu’en coûtent la méconnaissance du concept de rapports sociaux de production et la réduction d’une structure sociale à son habillage idéologique.
Or c’est cette double décomposition de la propriété foncière et du pouvoir politique, le long de la chaîne des dépendances personnelles que constitue la hiérarchie féodale prolongée par les rapports de servage, qui explique l’intrication des deux que Thomas Piketty relève bien comme la marque du féodalisme (plus largement des « sociétés ternaires, selon lui, mais nous savons ce que l’on doit en penser) mais qu’il ne parvient pas à expliquer, et pour cause. Il se contente de mentionner que :
« (…) le pouvoir inséparablement économique et politique était initialement exercé au niveau local, sur un territoire le plus souvent de faible dimension, parfois avec des liens relativement lâches avec un pouvoir central monarchique ou impérial plus ou moins lointain » (page 73).
« (…) ces droits de propriété du clergé et de la noblesse vont de pair avec des pouvoirs régaliens essentiels, notamment en termes de maintien de l’ordre et de pouvoir policier et militaire (c’est l’apanage en principe de la noblesse guerrière, mais il peut également être exercé au nom d’un seigneur ecclésiastique) ainsi qu’en termes de pouvoir juridictionnel (la justice est généralement rendue au nom du seigneur du lieu, là aussi noble ou religieux) » (page 74).
Sur la transition du féodalisme au capitalisme (en Europe)
Méconnaissant largement les spécificités des rapports féodaux de production et de propriété, Thomas Piketty est bien incapable de saisir la dynamique qui va faire naître, au sein même de ces rapports mais contre eux, en les subvertissant, dissolvant et décomposant, les prémices des rapports capitalistes de production. En somme, toute la transition du féodalisme au capitalisme lui échappe [9].
Aucun des éléments clefs de cette transition ne fait l’objet d’une attention particulière voire d’une simple mention de la part de Thomas Piketty. Ni le servage (dont il méconnaît les spécificités en tant que rapport de production : cf. ce qu’il en dit page 92 ou page 251), ni l’exclusion de la ville de l’organisation des rapports féodaux de production et de propriété (déjà mentionnée), qui va permettre la formation de villes et de réseaux de villes émancipés du pouvoir seigneurial de la noblesse et du clergé et fournir une échappatoire à des serfs en rupture de ban. Ni bien moins encore les effets à court et à long terme de la dynamique des échanges marchands qui va ainsi naître de la complémentarité mais aussi de la concurrence entre villes et campagnes, en les bouleversant les unes et les autres et en soulevant tout l’Occident médiéval, tout en le faisant sortir de son armature féodale.
Car l’entrée de la production agricole et artisanale paysanne dans les rapports marchands avec les villes va attiser la lutte des paysans pour alléger le poids du prélèvement seigneurial et surtout pour en modifier la forme, en substituant les redevances en espèces à celles en nature. Mais elle va aussi rapidement conduire à une différenciation socioéconomique au sein de la masse paysanne, en faisant apparaître d’un côté des « laboureurs », ainsi dénommés parce qu’ils possèdent un ou plusieurs trains de charrue avec lesquels ils peuvent mettre en culture des terres à la fois plus vastes et plus fertiles, accumulant donc fonds et moyens de travail agricoles, s’enrichissant en conséquence, ce qui va leur permettre de s’émanciper du servage en en rachetant les droits à leur seigneur ; et de l’autre des « brassiers » qui, comme leur nom l’indique, ne disposent que de leurs bras pour retourner la terre, dont l’entrée dans l’économie marchande et monétaire va tendre à appauvrir une partie d’entre eux au fil de leur endettement chronique, en les condamnant à survivre avec peine sur des parcelles de plus en plus réduites, tenus par conséquent de trouver un complément de ressources dans la location de leur bras à des seigneurs, des bourgeois ou des « laboureurs », et menacés d’expropriation dès lors qu’ils ne sont plus en mesure de s’acquitter de leurs redevances. En somme, une protobourgeoisie agrarienne d’un côté, rapidement renforcée par l’acquisition de terres par des marchands urbains soucieux de diversifier leurs investissements et de se parer du prestige de la propriété foncière, surtout si elle s’accompagne de quelque titre nobiliaire ; et un protoprolétariat rural de l’autre.
 Des modifications similaires vont affecter les structures sociales urbaines. La dynamique des échanges entre villes et campagnes va favoriser la formation et la montée en puissance d’une bourgeoisie marchande, dont une partie aura tôt fait de se convertir en protobourgeoisie industrielle en plaçant sous sa dépendance le travail domestique des paysans et artisans à la campagne et ceux des artisans des villes dépourvus d’organisation corporative, sous la forme du travail en commandite, antichambre de la manufacture éclatée (putting out system). Cette même dynamique ne fera par contre pas l’affaire de la petite-bourgeoisie de l’artisanat urbain qui n’aura d’autre recours pour se protéger que de renforcer ces organisations corporatives, dont la fermeture va accroître la sclérose et transformer les compagnons, naguère voués à devenir eux-mêmes des maîtres, en salariés à vie. Tandis que la fermeture des corporations ne laissera d’autre destin aux populations rurales, fuyant soit les excès de l’exploitation seigneuriale, soit la misère liée à leur expropriation tendancielle en se réfugiant en ville, que celui d’un protoprolétariat, d’une plèbe composée de manouvriers, de mendiants, de voleurs à la tire et de prostitué·e·s.
Des modifications similaires vont affecter les structures sociales urbaines. La dynamique des échanges entre villes et campagnes va favoriser la formation et la montée en puissance d’une bourgeoisie marchande, dont une partie aura tôt fait de se convertir en protobourgeoisie industrielle en plaçant sous sa dépendance le travail domestique des paysans et artisans à la campagne et ceux des artisans des villes dépourvus d’organisation corporative, sous la forme du travail en commandite, antichambre de la manufacture éclatée (putting out system). Cette même dynamique ne fera par contre pas l’affaire de la petite-bourgeoisie de l’artisanat urbain qui n’aura d’autre recours pour se protéger que de renforcer ces organisations corporatives, dont la fermeture va accroître la sclérose et transformer les compagnons, naguère voués à devenir eux-mêmes des maîtres, en salariés à vie. Tandis que la fermeture des corporations ne laissera d’autre destin aux populations rurales, fuyant soit les excès de l’exploitation seigneuriale, soit la misère liée à leur expropriation tendancielle en se réfugiant en ville, que celui d’un protoprolétariat, d’une plèbe composée de manouvriers, de mendiants, de voleurs à la tire et de prostitué·e·s.
Mais l’entrée des campagnes européennes dans la dynamique des échanges marchands avec les villes ne va pas moins bouleverser la condition des deux ordres privilégiés. Bon gré mal gré, elle va les contraindre à épouser leur temps en substituant du travail salarié au travail asservi sur leurs réserves mais aussi à étendre ces dernières, en trouvant tous les prétextes possibles pour exproprier les paysans de leurs tenures et reconstituer ainsi l’unité de leurs domaines, le tout dans le but de maximiser les possibilités de mise en valeur (marchande) de leurs terres (sol et sous-sol). Ce qui impliquera aussi de rompre peu ou prou avec leurs habitudes de gaspillage (suite pléthorique de courtisans, laquais et valets, dépenses somptuaires en objets de luxe et en fêtes, expéditions guerrières). Processus évidemment inégalement développé selon les localités et régions et aux résultats aléatoires, sauf quant à la différenciation socioéconomique qui va apparaître également dans leurs rangs, aggravant, déplaçant ou transformant celle antérieurement constituée dans le cadre des rapports féodaux. Ceux des membres de l’aristocratie nobiliaire et de la haute et moyenne noblesse auxquels l’entreprise réussira se convertiront soit en une classe purement rentière dès lors qu’ils affermeront leurs domaines à des bourgeois ou même à de gros paysans, soit en membres de la bourgeoisie industrielle qui, outre l’exploitation agricole de leurs domaines en régie directe, y ouvriront des moulins, des puits de mine, des marais salants, des hauts fourneaux, des manufactures textiles, etc. Ceux de leurs membres qui n’y réussiront pas et la petite noblesse qui n’en aura pas les moyens seront de plus en plus contraints pour tenir leur rang d’entrer au service du roi (comme militaires, diplomates, officiers ou simples courtisans) ou de Dieu (entrer dans les ordres) ou de compter sur quelques alliances matrimoniales avec une riche héritière bourgeoise, capable de redorer leur blason, et qui, inversement, y trouvera l’opportunité, pour elle et pour ses enfants, d’entrer dans les rangs convoités de la noblesse. Autant dire que, dans ces conditions, les rapports personnels de dépendance entre suzerains et vassaux constitutifs de la hiérarchie féodale vont se distendre et que cette hiérarchie va de plus en plus se convertir en un apparat auquel, paradoxalement, les nobles et les membres du clergé tiendront de plus en plus au fur et à mesure où il leur fournira les seuls éléments qui continueront à les distinguer des membres de la bourgeoisie montante, dont la richesse mais aussi quelquefois le pouvoir politique dépasseront bien souvent les leurs propres.
Rien de cela n’est même seulement évoqué au fil des mille deux cents pages de l’ouvrage. Pas plus que la manière dont l’extraversion commerciale et coloniale des sociétés ouest-européennes en direction des Amériques, des côtes africaines et de l’Asie maritime, inductrice de courants d’échanges commerciaux entre les ports européens et les comptoirs et possessions outre-mer qui ne vont cesser de gagner en puissance, va venir à la fois amplifier et accélérer l’ensemble des processus précédents à partir des XVe et XVIe siècles [10]. Ni la résultante générale de l’ensemble de ces processus : la montée en puissance mais et aussi et surtout la transformation des États monarchiques, donnant finalement naissance à des États absolutistes, dont le double pilier économique et social sera fourni par la haute noblesse (plus exactement même l’aristocratie nobiliaire) et la grande bourgeoisie marchande (commerciale et financière), que ces États appuieront en retour, la noblesse par le biais de la centralisation (sous forme de l’impôt) et de la redistribution (sous formes des subsides, prébendes, postes d’officiers civils et militaires, sinécures curiales, etc.) d’une rente foncière qu’elle peine de plus en plus à prélever directement (du fait de l’affaiblissement de son pouvoir seigneurial), la bourgeoisie marchande par le biais de toute la gamme des politiques mercantilistes. Sans compter l’exacerbation de la rivalité entre ces États dégénérant périodiquement en guerres dont les enjeux seront moins le contrôle et le repartage des territoires européens que ceux des courants d’échange avec l’outre-mer et leurs points d’appui.
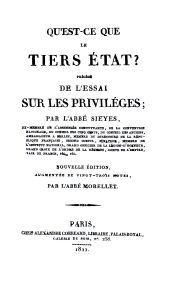 En fait, Thomas Piketty est si peu préoccupé de rendre effectivement compte de la transition du féodalisme au capitalisme qu’il s’autorise à enjamber ce processus pluriséculaire en l’espace… de quelques lignes (page 94), qui nous font passer de l’évocation de l’Europe de l’an mil à la publication du célèbre manifeste de l’abbé Sieyès intitulé Qu’est-ce que le Tiers État ?, publié à l’occasion de la convocation des États généraux du royaume de France au printemps 1789, qui débouchera sur les prémices de la Révolution quelques semaines plus tard. Seul le préoccupe alors de déterminer les effectifs et les ressources du clergé et de la noblesse à la veille de la Révolution, pour montrer que les deux ordres privilégiés de l’Ancien Régime constituent alors une très faible minorité de la population (en gros 2%), de surcroît en décroissance démographique absolue et relative depuis le milieu du XVIIe siècle, mais dont la puissance économique et politique reste intacte. Tous résultats incontestables mais de peu d’intérêt, tant ils sont connus et bien établis de longue date. Encore Thomas Piketty peine-t-il à en expliquer les raisons, en ce qui concerne tant la noblesse (pages 108-111) que le clergé (pages 116-120), faute précisément de s’être penché sur les transformations qui ont affecté leurs conditions durant l’Ancien Régime et dont j’ai brièvement fait état ci-dessus. S’agissant de la noblesse, il aurait ainsi pu saisir que sa décroissance démographique a été le pendant d’un processus de concentration et de centralisation de ses propriétés foncières et plus largement de ses actifs (en termes capitalistes) dont les raisons sont précisément liées à ces transformations ; si bien que les deux aspects apparemment contradictoires de son évolution en fin de course (sa décroissance démographique, le renforcement de sa puissance économique et politique) sont en fait parfaitement complémentaires.
En fait, Thomas Piketty est si peu préoccupé de rendre effectivement compte de la transition du féodalisme au capitalisme qu’il s’autorise à enjamber ce processus pluriséculaire en l’espace… de quelques lignes (page 94), qui nous font passer de l’évocation de l’Europe de l’an mil à la publication du célèbre manifeste de l’abbé Sieyès intitulé Qu’est-ce que le Tiers État ?, publié à l’occasion de la convocation des États généraux du royaume de France au printemps 1789, qui débouchera sur les prémices de la Révolution quelques semaines plus tard. Seul le préoccupe alors de déterminer les effectifs et les ressources du clergé et de la noblesse à la veille de la Révolution, pour montrer que les deux ordres privilégiés de l’Ancien Régime constituent alors une très faible minorité de la population (en gros 2%), de surcroît en décroissance démographique absolue et relative depuis le milieu du XVIIe siècle, mais dont la puissance économique et politique reste intacte. Tous résultats incontestables mais de peu d’intérêt, tant ils sont connus et bien établis de longue date. Encore Thomas Piketty peine-t-il à en expliquer les raisons, en ce qui concerne tant la noblesse (pages 108-111) que le clergé (pages 116-120), faute précisément de s’être penché sur les transformations qui ont affecté leurs conditions durant l’Ancien Régime et dont j’ai brièvement fait état ci-dessus. S’agissant de la noblesse, il aurait ainsi pu saisir que sa décroissance démographique a été le pendant d’un processus de concentration et de centralisation de ses propriétés foncières et plus largement de ses actifs (en termes capitalistes) dont les raisons sont précisément liées à ces transformations ; si bien que les deux aspects apparemment contradictoires de son évolution en fin de course (sa décroissance démographique, le renforcement de sa puissance économique et politique) sont en fait parfaitement complémentaires.
Quant au clergé, en France du moins, c’est très tôt, pendant les guerres de Religion (1562-1598), qu’il a su préserver ses possessions foncières et prérogatives seigneuriales accumulées au fil des siècles passées, d’une part en appuyant le « parti » catholique (car le triomphe du « parti » protestant se serait traduit par une sécularisation d’une grande partie voire de la totalité de ses biens, comme cela a été le cas en Suède, au Danemark-Norvège, en Angleterre, dans les Provinces-Unies ainsi que dans les États allemands ou Cantons helvétiques passés à la Réforme), d’autre part en parvenant à défendre son immunité fiscale jusqu’à la Révolution (ce qui n’aura pas été le cas de la noblesse), moyennant il est vrai la concession de nombreux « dons gratuits » à la monarchie [11].
Sur l’originalité de la société capitaliste
Incapable de saisir les spécificités des sociétés féodales (européennes), s’étant détourné de la compréhension de la dynamique qui va bouleverser ces dernières jusqu’à donner naissance aux rapports capitalistes de production et à leur emprise croissante sur l’ensemble de la praxis sociale, il était inévitable que Thomas Piketty échouât à comprendre le résultat de ce processus pluriséculaire. Mais cet échec porte témoignage de bien d’autres lacunes et travers de son entreprise et de sa démarche.
La dynamique historique qui bouleverse les sociétés féodales européennes jusqu’à les faire disparaître au cours des temps modernes et au début de l’époque contemporaine (pour en rester aux divisions historiographiques habituelles) donne naissance, selon Thomas Piketty, à des « sociétés de propriétaires » (passim). Forgée pour caractériser les sociétés capitalistes, l’expression est pour commencer curieuse, avant même d’être fallacieuse. Car elle suggère qu’il pourrait y avoir des sociétés de non-propriétaires, ce qui est une absurdité : toute société implique une forme ou un régime spécifique (éventuellement plusieurs même) d’appropriation par les hommes de la nature et des produits de la transformation de la nature par leur travail, régime qui ne prend pas nécessaire la forme spécifique et séparée d’un droit codifié en tant que tel mais le plus souvent celle de coutumes garanties par la crainte des autorités politiques et religieuses qui les font respecter, en définissant ainsi des propriétaires ainsi d’ailleurs que des non-propriétaires, éventuellement. En fait, ce qui distingue les sociétés capitalistes des sociétés précapitalistes, c’est tout simplement une nouvelle forme ou un nouveau régime de la propriété, adossé à des rapports sociaux de production spécifiques. Thomas Piketty en convient lui-même, même s’il peine à définir ce nouveau régime et s’il se trompe lourdement et quant à sa genèse et quant à sa nature.
Nous avons vu plus haut que le régime féodal de la propriété se caractérisait, d’une part, par sa décomposition (le fait que l’usus, le fructus et l’abusus étaient ordinairement distribués entre des mains différentes), d’autre part par la confusion aux différents niveaux de la hiérarchie féodale entre propriété et souveraineté (exercice du pouvoir politique), celle-ci étant ainsi en définitive tout aussi bien émiettée que celle-là. Par opposition, le régime capitaliste de propriété va consister, d’une part, à séparer radicalement propriété et souveraineté, d’autre part, à remettre la première aux mains de personnes individualisées (dont l’individualisation y trouvera d’ailleurs une de ses conditions essentielles de possibilité) tandis que la seconde sera l’apanage d’un État. Ce que Thomas Piketty saisit bien et qu’il présente en ces termes :
« (…) il s’agissait de distinguer nettement la question des pouvoirs régaliens (sécurité, justice, violence légitime), sur lesquels l’État centralisé devait désormais avoir le monopole ; et la question du droit de propriété, qui devait devenir l’apanage de l’individu privé, et qu’il fallait définir de façon pleine, entière et inviolable, sous la protection de l’État, qui devait en faire sa mission première, voire unique. » (page 128)
« Il s’agissait d’opérer une séparation stricte entre les fonctions régaliennes (monopole de l’État centralisé) et le droit de propriété (apanage de l’individu privé), alors que la société trifonctionnelle reposait au contraire sur l’enchevêtrement de ces relations. » (pages 142-143)
Par contre, Thomas Piketty néglige en partie ou méconnaît même les transformations que cette séparation de la propriété et de la souveraineté va opérer sur l’une et l’autre. Car, en se concentrant entre les mains d’individus distincts et séparés les uns des autres, la propriété retrouvera ainsi en régime capitaliste la forme quiritaire ou absolue que lui avait déjà conférée le droit romain, réunissant entre les mains du propriétaire (en l’occurrence un individu) ses trois composantes constitutives (usus, fructus, abusus), tout en conférant à son détenteur une absolue liberté d’en disposer à sa guise (sauf à nuire à d’autres propriétaires privés ou à l’ordre civil garant de l’ensemble des propriétés privées) et une égale garantie de droit et d’obligation quant aux conditions où il pourra en user, notamment dans ses rapports contractuels avec les autres propriétaires privés. Inversement, en devenant l’apanage de l’État (qui se reconstitue du même coup), l’exercice de la souveraineté lui fera prendre la forme de pouvoir public impersonnel, entendons : un pouvoir qui n’appartient à personne, pas même (et surtout pas) à ceux qui sont chargés de l’exercer, à quelque niveau que ce soit ; un pouvoir qui se distingue donc formellement des divers pouvoirs privés qui continuent à s’exercer, en marge de lui et sous lui (sous son contrôle), dans le cadre de la société civile : pouvoirs liés à la naissance, à la propriété, à la compétence, à la chance, etc. ; un pouvoir dont les actes ne doivent pas être l’expression d’intérêts particuliers mais exclusivement celle de l’intérêt général, ici assimilable au maintien de l’ordre civil, garantissant à chacun le respect de sa subjectivité juridique et la possibilité de contracter librement ; un pouvoir respectant par conséquent toutes les prérogatives des individus en tant que propriétaires privés et, plus largement, sujets de droit ; un pouvoir s’adressant par conséquent à tous de manière égale, soumettant tous aux mêmes obligations et garantissant à tous les mêmes droits ; en définitive un pouvoir qui apparaît non pas comme le pouvoir d’un homme ou d’un groupe d’hommes sur d’autres hommes mais comme le pouvoir d’une règle impersonnelle et impartiale s’appliquant à tous les hommes et qu’il s’agit de faire respecter par tous : la loi [12].
Que ces formes de propriété et de souveraineté soient adéquates aux rapports capitalistes de production, à commencer par le simple procès de mise en valeur du capital, c’est ce qui apparaît immédiatement. Impossible de mettre en œuvre ce procès sans être pleinement propriétaire (réunir entre ses mains l’usus, le fructus et l’abusus) tant des conditions de ce procès (le capital-argent, les moyens de production et les forces de travail contre lesquels il s’échange, le procès de production qui résulte de leur combinaison) que de son résultat (le capital-marchandise et l’argent qui en réalise la valeur, avec la plus-value qu’elle contient). Et la mise en œuvre d’un pareil procès est tout aussi impossible si les différents capitalistes et, plus largement l’ensemble des agents intervenant sur les marchés, ne disposent d’une parfaite liberté d’usage de leurs propriétés (sous forme de marchandise ou d’argent) et d’une égale condition de droit quant à leur usage et aux résultats de ce dernier. C’est bien pourquoi le processus de formation des rapports capitalistes de production n’a pu se développer que conjointement à la transformation des rapports de propriété et de souveraineté précédemment analysée, les deux se soutenant mutuellement.
C’est pourquoi d’ailleurs Thomas Piketty abuse le lecteur en lui faisant croire que cette séparation entre propriété et souveraineté et leurs transformations consécutives ont été principalement l’œuvre de la Révolution française :
« (…) la Révolution de 1789 marque une rupture particulièrement nette entre l’Ancien Régime, qui peut être considéré comme un exemple paradigmatique de société ternaire, et la société bourgeoise qui s’épanouit en France au XIXe siècle, qui apparaît comme l’archétype de la société de propriétaires, forme historique majeure qui succède dans de nombreux pays aux sociétés ternaires. » (page 86)
« Dans ce chapitre, je vais revenir de façon plus détaillée sur la Révolution de 1789, qui marque une rupture emblématique entre la société d’ordres d’Ancien Régime et la société bourgeoise et propriétariste qui s’épanouit en France au XIXe siècle. » (page 127)
Une fois de plus, il méconnaît complètement tout le processus pluriséculaire de bouleversement des rapports de production et de propriété qui fait passer les sociétés européennes du féodalisme au capitalisme. S’il ne saurait être question de minorer l’importance des bouleversements institutionnels et idéologiques opérés par la Révolution française, celle-ci n’aura cependant fait que parachever une entreprise entamée et déjà largement réalisée bien avant que nos braves révolutionnaires entrent en scène, qui débute par la redécouverte et la réintroduction du droit romain à la fin du XIe siècle à l’université de Bologne et sa diffusion dans la pratique sociale, à commencer par ceux des commerçants et négociants élaborant un lex mercatoria spécifique [13]. Thomas Piketty en apporte d’ailleurs lui-même involontairement la preuve, d’une part, en faisant remarquer qu’une partie de l’œuvre de nos sans-culottes et autres Montagnards aura été remise en question après Thermidor, sous le Directoire, le Consulat et l’Empire, sans compter évidemment la Restauration (pages 138 et 150), sans que pour autant la dynamique capitaliste n’ait été remise en cause tout au long de ces décennies et des suivantes, en s’appuyant précisément sur tout ce qui avait été accompli avant la tourmente révolutionnaire. Tandis que, d’autre part, les transformations de la propriété et de la souveraineté nécessaires au développement des rapports capitalistes de production n’auront pas nécessité le passage par une pareille épreuve révolutionnaire sous d’autres cieux, par exemple au Royaume-Uni (pages 201 à 205) et en Suède (pages 226 à 231) pour en rester aux exemples développés par Thomas Piketty lui-même.
Mais là n’est pas même l’essentiel. En se concentrant sur les transformations de la propriété et de la souveraineté dont sont nées les soi-disant « sociétés de propriétaires » tout en omettant d’explorer les rapports capitalistes de production qui leur servent de soubassements et qui en ont été les moteurs, Thomas Piketty méconnaît complètement la nature exacte de la forme spécifiquement capitaliste de propriété. Car la triade : propriété privée – liberté – égalité, qui constitue le fin mot des rapports capitalistes de propriété et de toute l’idéologie propriétariste telle que l’entend Thomas Piketty, ne fait qu’exprimer les conditions dans lesquelles les sujets sociaux (les individus propriétaires) opèrent au sein du procès de circulation du capital et dans la sphère plus largement de la circulation marchande [14]. Mais, comme le fait encore remarquer Marx, cela ne nous dit rien quant à ce que sont leurs conditions et leurs rapports au sein du procès de production. Or, derrière le voile idyllique de la circulation où tous les individus apparaissent comme des propriétaires privés, libres de leur personne et de leurs biens et égaux en droit, se trame une tout autre réalité où l’un (le capitaliste) figure comme propriétaire de capital-argent qui lui permet d’acquérir moyens de production et forces de travail tandis que l’autre (le travailleur salarié) ne possède que sa seule force de travail, qu’il cherche à mettre à la disposition de qui veut l’employer… pour l’exploiter. Alors émerge cette singulière figure du « travailleur libre », ainsi que le désigne ironiquement Marx, et même doublement libre : libre de toute dépendance personnelle et communautaire (mais ne dépendant plus de personne, plus personne ne répond non plus de lui) et libre de toute possession (de moyens de production et de moyens de consommation) hormis sa puissance subjective de travail, ses capacités (diversement qualifiées) de travailler, de produire… dont l’actualisation dépend d’autres que de lui-même. Figure qui semble inconnue de Thomas Piketty, dont Marx montre qu’elle présuppose tout un processus d’expropriation (de fait et de droit) : de dépossession de tous moyens de production propres et, par conséquent, de tous moyens de consommation immédiatement disponibles, expropriation qui passe par la destruction violente ou la dissolution progressive de tous les rapports précapitalistes de production au sein desquels le producteur direct était au contraire lié, de manière « libre » (dans les communautés primitives, dans les communautés patriarcales, dans la production marchande simple) ou de manière contrainte (dans l’esclavage ou le servage). Autrement dit, désigner comme « société de propriétaires » la société capitaliste, dont la spécificité historique est précisément de présupposer l’expropriation de l’immense majorité de ses membres à l’égard des conditions immédiates de leur reproduction en tant que sujets sociaux, est d’une ironie aussi cruelle qu’involontaire sans doute, digne en tout cas d’une novlangue inversant le sens des mots qu’elle utilise, dont Thomas Piketty se rend coupable du fait de sa fascination pour le voile juridique et idéologique qui entoure les rapports capitalistes de production et de sa méconnaissance profonde de ces derniers.
Car toute l’analyse de Thomas Piketty témoigne en définitive de cette fascination pour la forme spécifiquement capitaliste de la propriété. Certes, son évaluation de cette dernière semble a priori nuancée, Thomas Piketty prenant soin de se démarquer pour partie de ce qu’il appelle « l’idéologie propriétariste » :
« L’idéologie propriétariste a une dimension émancipatrice qui est réelle et ne doit jamais être oubliée, et en même temps elle porte en elle une tendance à la quasi-sacralisation des droits de propriété établis dans le passé – quelles que soient leur ampleur et leur origine – qui est tout aussi réelle, et dont les conséquences inégalitaires et autoritaires peuvent être considérables. » (page 151)
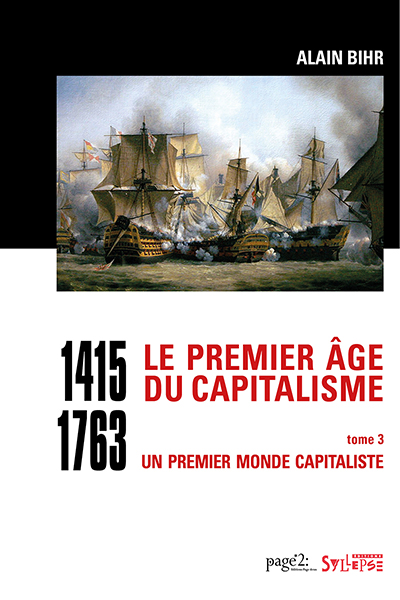 Mais, à y regarder de plus près, les deux éléments de cette évaluation sont également trompeurs précisément parce que celle-ci se fonde sur les seuls rapports de propriété en omettant les rapports de production sous-jacents. Ainsi « la promesse de stabilité sociale et politique, mais aussi d’émancipation individuelle » incluse selon Thomas Piketty dans « l’idéologie propriétariste », solennellement proclamée dans les déclarations des droits auxquelles donnèrent lieu les Révolutions états-unienne et française, est-elle fallacieuse non seulement par le fait que le régime de propriété et, plus largement, de droits civils et politiques qu’elle implique exclut primitivement les femmes et les esclaves (ibidem). Car, même étendue à tous et à toutes, elle ne tient pas davantage ses promesses émancipatrices. Considérer que « (…) la propriété privée, correctement redéfinie dans ses limites et dans ses droits, fait effectivement partie des dispositifs institutionnels permettant aux différentes aspirations et subjectivités individuelles de s’exprimer et d’interagir de façon constructive » (page 156), c’est tout simplement méconnaître les effets profondément aliénants des rapports de production capitalistes, les effets de dépossession dans toutes ses dimensions qui mettent en œuvre la propriété privée : de quelles possibilités concrètes d’exprimer ses aspirations et sa subjectivité individuelle et d’interagir de façon constructive avec ses semblables dispose celle ou celui que les rapports capitalistes de production vouent à des conditions d’emploi aléatoires quand ce n’est pas au chômage intermittent ou continu, à des conditions de travail dégradantes ou inhumaines, à des salaires de misère ou même tout juste situés au-dessus du seuil de pauvreté et à l’absence de toute perspective de changement de sa situation pour soi et pour les siens ? Ce qui n’est autre que la situation faite à l’immense majorité de l’humanité sous le régime réputé émancipateur de la propriété privée capitaliste.
Mais, à y regarder de plus près, les deux éléments de cette évaluation sont également trompeurs précisément parce que celle-ci se fonde sur les seuls rapports de propriété en omettant les rapports de production sous-jacents. Ainsi « la promesse de stabilité sociale et politique, mais aussi d’émancipation individuelle » incluse selon Thomas Piketty dans « l’idéologie propriétariste », solennellement proclamée dans les déclarations des droits auxquelles donnèrent lieu les Révolutions états-unienne et française, est-elle fallacieuse non seulement par le fait que le régime de propriété et, plus largement, de droits civils et politiques qu’elle implique exclut primitivement les femmes et les esclaves (ibidem). Car, même étendue à tous et à toutes, elle ne tient pas davantage ses promesses émancipatrices. Considérer que « (…) la propriété privée, correctement redéfinie dans ses limites et dans ses droits, fait effectivement partie des dispositifs institutionnels permettant aux différentes aspirations et subjectivités individuelles de s’exprimer et d’interagir de façon constructive » (page 156), c’est tout simplement méconnaître les effets profondément aliénants des rapports de production capitalistes, les effets de dépossession dans toutes ses dimensions qui mettent en œuvre la propriété privée : de quelles possibilités concrètes d’exprimer ses aspirations et sa subjectivité individuelle et d’interagir de façon constructive avec ses semblables dispose celle ou celui que les rapports capitalistes de production vouent à des conditions d’emploi aléatoires quand ce n’est pas au chômage intermittent ou continu, à des conditions de travail dégradantes ou inhumaines, à des salaires de misère ou même tout juste situés au-dessus du seuil de pauvreté et à l’absence de toute perspective de changement de sa situation pour soi et pour les siens ? Ce qui n’est autre que la situation faite à l’immense majorité de l’humanité sous le régime réputé émancipateur de la propriété privée capitaliste.
Et, de même, les inégalités qui accompagnent la mise en œuvre du régime capitaliste de propriété ne résultent pas seulement de « la quasi-sacralisation des droits de propriété établis dans le passé », elles sont l’œuvre présente des rapports de production que ce régime enveloppe et légitime. Si Thomas Piketty s’était intéressé un tant soit peu à ces rapports de production, il saurait que la dynamique de l’accumulation du capital génère nécessairement une polarisation sociale croissante, qu’en régime capitaliste l’accumulation de la richesse sociale et des moyens de produire cette richesse s’accompagne inéluctablement d’une aggravation de ces inégalités de revenus et de patrimoines qui retiennent tant son attention, du fait d’une part de la distorsion croissante dans le partage de la valeur nouvellement produite entre plus-value (donc profits, intérêts et rentes) et salaires, d’autre part d’une extension et d’une aggravation de la pauvreté et de la misère avec le développement de la surpopulation relative qui est également l’œuvre de cette accumulation, ainsi précisée par Marx :
« Les mêmes causes qui développent la force expansive du capital amenant la mise en disponibilité de la force ouvrière, la réserve industrielle doit augmenter avec les ressorts de la richesse. La grandeur relative de l’armée industrielle de réserve s’accroît donc en même temps que le ressort de la richesse. Mais plus cette armée de réserve grossit, comparativement à l’armée active du travail, plus grossit la surpopulation consolidée, excédent de population, dont la misère est inversement proportionnelle aux tourments de son travail. Plus s’accroît enfin cette couche des Lazare de la classe salariée, plus s’accroît aussi le paupérisme officiel. Voici la loi absolue, générale, de l’accumulation capitaliste. L’action de cette loi, comme toute autre, est naturellement modifiée par les circonstances particulières » [15].
Ignorant cette loi, Thomas Piketty ne se rend pas même compte qu’il la vérifie et l’illustre pourtant lui-même en montrant comment, durant le long XIXe siècle s’achevant avec l’éclatement de la Première Guerre mondiale, l’épanouissement d’une « société de propriétaires » s’est accompagné d’un accroissement des inégalités de patrimoines et, dans une moindre mesure, des revenus en France, atteignant des niveaux supérieurs à ceux enregistrés à la veille de la Révolution (pages 160-163), et que des évolutions similaires ont été enregistrées dans les autres « sociétés de propriétaires » européennes sur lesquelles Thomas Piketty s’est penché, Royaume-Uni et Suède (pages 236-240), vouant l’immense majorité de leurs membres à n’être propriétaires de rien, à peine d’eux-mêmes. Car, laissée à elle-même, sans les actions correctrices que peuvent lui apporter des politiques de redistribution articulant recettes publiques ciblées (sous formes de prélèvements obligatoires : d’impôts et de cotisations sociales) et dépenses publiques non moins ciblées (sous formes d’allocations sociales mais aussi d’accès gratuit ou quasi gratuit à des équipements collectifs et à des services publics), la dynamique du capital ne peut qu’être profondément inégalitaire et qu’elle le reste d’ailleurs, simplement à un degré moindre, en dépit de la mise en œuvre de pareilles actions correctrices éventuelles.
Or tout le projet politique de Thomas Piketty consiste simplement en la mise en œuvre de pareilles corrections de la loi générale d’accumulation du capital :
« Plus généralement, on peut utiliser les institutions de la propriété privée pour les dimensions émancipatrices qu’elles peuvent apporter (en particulier pour permettre à la diversité des aspirations individuelles de s’exprimer, ce que les sociétés communistes du XXe siècle ont tragiquement choisi d’oublier), tout en les encadrant et les instrumentalisant au sein de l’État social, d’institutions redistributrices, telles que la progressivité fiscale, et plus généralement de règles permettant de démocratiser et de partager l’accès au savoir, au pouvoir et à la richesse (comme ont tenté de le faire les sociétés sociales-démocrates au XXe siècle, même si l’on peut juger ces tentatives insuffisantes et inabouties ; nous y reviendrons) » (page 153).
Ce qui revient tout simplement à confirmer sa survalorisation des vertus de ce régime de propriété, qu’il érige en horizon indépassable de notre temps. Nous aurons à y revenir nous aussi. (A suivre)
___________
[1] Il aurait été trop long et trop fastidieux de réfuter les analyses de Thomas Piketty à ce sujet. Le lecteur que cela intéresse trouvera matière à une pareille réfutation dans la dernière partie de Le premier âge du capitalisme, Tome 3 : Un premier monde capitaliste, Page 2 et Syllepse, Lausanne et Paris, 2019, où sont successivement analysés les cas de l’Empire ottoman, de l’Empire safavide (shiite), de la Chine et du Japon des Tokugawa.
[2] C’est ainsi que Georges Dumézil l’a conçu et entendu, par exemple dans Mythe et épopée. Tome 1 : L’idéologie des trois fonctions dans les épopées des peuples indo-européens, Paris, Gallimard, 1968. Ses travaux ont d’ailleurs surtout porté sur les langues, religions et mythologies des sociétés indo-européennes, non pas d’abord sur leurs structures. Et c’est aussi en ce sens que Georges Duby l’a compris dans son analyse de la société féodale : cf. Les trois ordres ou l’imaginaire du féodalisme, Paris, Gallimard, 1978. Ouvrage dans lequel il montre, de surcroît, que cet imaginaire est relativement tardif (il est le produit du Moyen Age central, entre le XIe et le XIIIe siècle, lorsque le féodalisme est déjà bien constitué) et qu’il a eu du mal à s’y imposer d’ailleurs.
[3] «Capital et idéologie»: un titre en trompe-l’œil.
[4] Ce que Thomas Piketty doit finalement lui-même reconnaître : « Il s’agit de sociétés dans lesquelles deux classes dotées de légitimité, de fonction et d’organisation distinctes, la classe cléricale et la classe nobiliaire, contrôlent chacune une proportion considérable des ressources et des biens (approximativement entre un quart et un tiers des propriétés pour chacun des deux groupes, soit au total entre la moitié et les deux tiers pour les deux groupes réunis, et parfois davantage dans certains pays, comme nous le verrons quand nous étudierons le cas du Royaume-Uni), ce qui leur permet de jouer pleinement leur rôle social et politique dominant. » (page 120)
[5] Loin que, comme le répète à l’envi Thomas Piketty (pages 84-85, 91-92, 248), le schéma ternaire ait eu pour effet d’unifier et d’uniformiser la situation de tous travailleurs du tiers état, cette différence joue un rôle essentiel tant dans la société féodale que dans la transition du féodalisme au capitalisme, comme je le rappellerai encore dans un moment.
[6] Les lignes suivantes condensent des développements détaillés dans La préhistoire du capital, Lausanne, Page 2, 2006, Chapitre II, disponible en ligne http://classiques.uqac.ca/contemporains/bihr_alain/prehistoire_du_capital_t1/prehistoire_du_capital_t1.html
[7] « (…) la notion même de droit de propriété prenait une signification spécifique dans les sociétés trifonctionnelles (et incluait des droits juridictionnels et régaliens non pris en compte ici) (…) » (page 116). Cf. aussi ce qu’il dit plus loin des lods (pages 134 et suivantes).
[8] La principale exception est constituée par les ordres monastiques dont c’est une des raisons de la montée en puissance au cours du Moyen Age. S’y adjoignent le fait que leurs domaines ne sont pas victimes de ce facteur de démembrement partiel de la propriété laïque qu’est l’héritage et le fait que ces ordres vont rapidement bénéficier de dotations foncières de la part de seigneurs laïcs (qui ont bien des péchés à se faire pardonner !). A noter cependant qu’il a également subsisté durant tout le Moyen Age une minorité (d’importance variable selon les régions) de paysans dit alleutiers, pleinement propriétaires de leur terre, et par conséquent non soumis au pouvoir seigneurial, si ce n’est dans sa dimension banale.
[9] J’ai moi-même analysé cette transition dans La préhistoire du capital, op.cit, Chapitre III et Chapitre IV ainsi que dans Le premier âge du capitalisme, Tome 2 : La marche de l’Europe occidentale vers le capitalisme, Page 2 et Syllepse, Lausanne et Paris, 2019, dont je condense ici les principaux résultats.
[10] Si cette extraversion est évoquée, essentiellement dans sa dimension coloniale, en quelques lignes (page 250, page 304), son incidence sur la dynamique de la transition du féodalisme au capitalisme en Europe occidentale est totalement absente de l’analyse de Thomas Piketty.
[11] Pour plus de détail, cf. La marche de l’Europe occidentale…, op. cit., Chapitre VI.2, pages 360-383.
[12] Pour plus de détails sur la solidarité entre cette forme de propriété et cette forme de souveraineté, cf. La marche de l’Europe occidentale…, op. cit., Chapitre VII.1, pages 465-473.
[13] Pour plus de détail, cf. La marche de l’Europe occidentale…., op. cit., Chapitre VII.1, pages 473-509.
[14] Cf. Marx dans le fragment conservé de la version primitive de la Critique de l’économie politique, http://classiques.uqac.ca/classiques/Marx_karl/contribution_critique_eco_pol/contribution_critique.html, notamment pages 211-215.
[15] Le Capital, Livre I, Chapitre XXV, http://classiques.uqac.ca/classiques/Marx_karl/capital/capital_livre_1/capital_livre_1_3/fichiers_MIA/Capital_1_1_s7.pdf, page 34.


Merci Alain Bihr de nous éclairer aussi brillamment sur Piketty et, plus globalement, d’armer notre esprit critique.